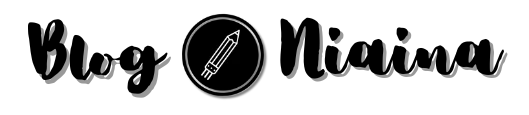À Madagascar, une ombre plane sur le quotidien des paisibles villages de la Grande Île : celle des dahalo, ces redoutables voleurs de bœufs. Loin d’être un phénomène anodin, ce fléau ancestral s’est muté en une véritable économie parallèle et gangrène désormais de nombreuses régions. Attaques sanglantes, villages désertés, cheptels décimés… Les dégâts sont immenses, notamment dans les contrées pauvres du sud où sévissent ces bandes criminelles.
Ce phénomène prend racine au cœur même des traditions des ethnies Antandroy et Bara, deux peuples d’éleveurs pour qui le vol de zébus représentait jadis un rite initiatique, une épreuve devant jalonner le passage à l’âge adulte du jeune homme. Mais ce qui n’était alors qu’un simple larcin ponctuel s’est aujourd’hui transformé en un véritable fléau sécuritaire.
Car en dépit des efforts déployés par les autorités, les rangs des dahalo ne cessent d’enfler. Chaque année, de nouvelles recrues viennent grossir les rangs de ces bandes armées, souvent poussées par la pauvreté et l’appât du gain facile. Mais outre ces facteurs économiques, de multiples raisons psychologiques, sociales ou culturelles peuvent aussi conduire à l’embrigadement. Alors que se terrent les motivations de ces jeunes voleurs ? Plongeons au cœur de ce terreau de la délinquance rurale pour en saisir tous les ressorts.
Facteurs socioculturels et traditions
Au cœur de la délinquance rurale malgache, des racines ancestrales insoupçonnées viennent nourrir le terreau du phénomène des dahalo. Dans ces contrées reculées où l’élevage de zébus façonne l’identité même des communautés Antandroy et Bara, le vol de bétail revêt une dimension culturelle et initiatique particulière. Une tradition pluriséculaire conférant une véritable aura aux voleurs aguerris.
Car dans ces peuples du sud, le prestige d’un homme se mesure à l’aune du nombre de têtes qu’il possède. Le zébu, bien plus qu’une simple richesse matérielle, incarne un symbole de virilité incontournable. Une véritable pomme de discorde qui pousse souvent les jeunes gens à se lancer dans le larcin pour assouvir ce besoin de reconnaissance. « Meurs ou vole !« , leur intime-t-on parfois crûment pour rappeler cet impératif social.
Une pression culturelle d’autant plus féroce que le vol de zébus constituait, dans les temps immémoriaux, un rite initiatique obligé pour chaque garçon. Une véritable épreuve qui devait marquer le passage de l’enfance à l’âge adulte, cautionnée par la tradition. « Il n’est pas encore un homme, il n’a pas encore volé ! », raillait-on celui qui tardait trop à accomplir son larcin. Un détour obligé sur la route de la maturité, en somme…
Aujourd’hui encore, dans les villages les plus reculés, nombreux sont ceux qui perpétuent ces croyances. Le culte du vol se transmet de génération en génération, par une véritable filiation du « métier ». Le fils suit donc les traces de son père quand ce dernier fut lui-même un valeureux dahalo dans sa jeunesse, poussé par l’héritage familial ou la glorification sociale du larcin bovin.
Lire aussi : Le ravage des sectes à Madagascar
Facteurs économiques
Si les mobiles culturels ont longtemps été le principal moteur du phénomène dahalo, les contraintes économiques sont aujourd’hui la principale rampe de lancement de ce fléau grandissant. Dans les régions les plus paupérisées de la Grande Île, l’appât du gain facile vient doubler l’aura romantique du vol de bétail, constituant un puissant facteur d’embrigadement pour la jeunesse rurale.
La raison en est simple : face à la misère ambiante et au manque de perspectives, le larcin offre une échappatoire aisée, un moyen rapide de renflouer les maigres réserves du foyer. Il suffit de quelques têtes de bétail pour amasser une petite fortune, de quoi assurer alimentation saine et une vie décente pendant de longues semaines. Difficile, dans ces conditions, de résister à la tentation du butin facile…
Certains n’entrent même pas dans le banditisme par cupidité, mais par désir de récupérer leur bien, volé auparavant par une bande rivale. Un simple mobile de vengeance, ou de rétablissement d’un dû bafoué. On l’a bien compris : dans ce Far West malgache où la loi du plus fort régit les rapports, la pratique du repren-dré ( » reprendre par la force ce qui a été volé ») ne soulève souvent aucun état d’âme.
D’autres encore, sans être véritablement pauvres, cèdent à l’appel du pécule facile en prévision des grands événements festifs jalonnant la vie rurale. Les fêtes de fin d’année, mariages ou autres cérémonies représentent en effet de lourdes charges que le petit pécule journalier ne suffit pas toujours à couvrir. Voler quelques têtes de bétail permet alors de « se faire la main » rapidement avant les réjouissances.
Bien que motivés par la gêne matérielle, ces jeunes voleurs « à la petite semaine » n’en sont pas moins dangereux que leurs congénères. Et si la détresse matérielle peut expliquer leur dérive, rien ne saurait pourtant l’excuser totalement. À situation désespérée, remède désespéré ? La spirale de la violence n’en reste pas moins effroyable…
Facteurs sociaux et environnementaux
Au-delà des considérations économiques et culturelles, le terreau du phénomène dahalo trouve aussi ses racines dans un bouillon de ferments sociaux particulièrement délétères. Car dans ces campagnes reculées de la Grande Île, l’engrenage du déclassement et de l’exclusion pousse bien des jeunes dans le giron des bandes criminelles, faute d’alternatives crédibles.
Las des pesanteurs familiales et des traditions étouffantes, certains choisissent tout simplement la voie de la révolte et du rejet. En s’affiliant à un gang de voleurs, ils expriment un ras-le-bol généralisé et clament haut et fort leur refus des carcans sociaux ancestraux. Une émancipation à la fois brutale… et meurtrière.
D’autres, en revanche, n’ont d’autre choix que l’embrigadement forcé sous la menace ou les mauvaises influences. Issus de familles défavorisées ou décomposées, ils trouvent auprès des caïds de la pègre une figure d’autorité substitutive, un simulacre de valorisation identitaire. Une fuite en avant tragique dans la délinquance, vue comme un mirage de reconnaissance sociale.
Il arrive aussi que ce soient des conflits avec les autorités coutumières qui précipitent la dérive. Face au refus d’un jeune de se plier aux diktats du village, bien des chefs traditionnels n’hésitent pas à recourir à l’exclusion pure et simple. Poussé au ban de sa communauté, ce paria voit alors dans le banditisme l’unique voie de subsistance restante.
Enfin, chez d’autres encore, les mobiles sont d’ordre purement sociétal : en rejoignant les rangs des dahalo, ils espèrent pouvoir assouvir leurs désirs de rébellion sociale. Car si le vol de zébus demeure la principale activité de ces bandes armées, elles n’en sont pas moins de véritables contre-pouvoirs revendiquant une certaine justice redistributive. Leurs cibles ? Les nantis et les puissants de ce monde rural considérés comme des oppresseurs par la jeunesse désœuvrée.
Lire aussi : Le tromba, un rituel de possession unique à Madagascar
Autres motivations
Si la grille de lecture socioculturelle et économique permet de cerner l’essentiel des motivations à l’œuvre, d’autres ressorts, plus insidieux encore, entrent également en jeu dans l’embrigadement des jeunes dahalo. Un méli-mélo de déterminants pour le moins inattendus, qui rappellent avec force qu’aucun facteur ne doit être négligé dans l’analyse de ce fléau complexe.
Chez certains, très tôt décrocheurs des bancs de l’école, le choix du grand banditisme relève parfois d’une pure oisiveté cultivée. Pourquoi, en effet, se damner à la tâche dans les champs quand l’alternative du larcin facile existe ? Bien plus attrayante que le rude labeur agricole, la pratique du vol apparaît comme un passe-temps pour le moins lucratif… et excitant !
Une quête de sensations fortes qui, il faut bien l’admettre, trouve un terreau des plus fertiles dans ces aventures de grand chemin. Alors que les villages s’enlisent dans une léthargie rurale, l’appel de l’adrénaline et des émotions vives finit par devenir irrésistible pour bien des jeunes assoiffés de frissons. Danger, montées d’adrénaline, rushs extrêmes : le « métier » des dahalo a de quoi combler les âmes les plus avides de kick.
Certains n’hésitent même pas à braver le pire pour savourer cette insouciante liberté : les représailles sanglantes et les risques de mort violente ne semblent même plus être un frein. « Qu’importe si je me fais tuer, je vivrai libre ! », lâchait d’ailleurs un jeune bandit dans une récente interview. Une pulsion souvent mortelle, mais sans cesse renouvelée…
Alors que le phénomène dahalo menace toujours plus la stabilité de Madagascar, aucune piste ne doit donc être écartée pour en saisir les tenants et aboutissants. Derrière ces multiples visages de la délinquance rurale se cachent en réalité des fils complexes, une toile aux mille rouages sur laquelle les autorités peinent encore à prendre prise. Un défi de taille pour la Grande Île.
Le cri d’alarme de la Grande Île
Qu’elles soient culturelles, économiques, sociales ou psychologiques, les racines du fléau des dahalo sont multiples et profondément ancrées dans la réalité rurale malgache. Un terreau complexe, nourri par la pauvreté, les pesanteurs traditionnelles et les failles sociétales, qui ne cesse d’alimenter le phénomène année après année.
Face à cette nébuleuse aux ramifications insoupçonnées, les réponses sécuritaires classiques semblent vouer à l’échec. Car aussi musclées soient-elles, ces approches répressives ne s’attaquent qu’aux symptômes, sans pouvoir réellement tarir la source. Pour enrayer durablement la menace des dahalo, une véritable politique de développement économique et social dans les campagnes reculées sera indispensable.
Si rien n’est fait, la perspective d’avenir reste des plus sombres pour la Grande Île. En continuant d’enfler, le phénomène pourrait bien finir par provoquer une véritable désertification des zones rurales, vidées de leurs forces vives par cette insécurité galopante. Avec à la clé un appauvrissement général du pays et un risque accru de déstabilisation.
Briser ce cercle vicieux nécessite donc des actions coordonnées à tous les niveaux : réinsertion économique, campagnes de sensibilisation, mesures d’accompagnement pour la jeunesse… Autant de chantiers d’urgence pour résoudre cette épineuse équation à multiples inconnues. Une entreprise de longue haleine, mais la seule à même d’éviter le pire pour Madagascar. Le coût de l’inaction serait bien trop élevé.
Photo à la une : Rijasolo